Imagologie: du voyage à l’étude des images réciproques. L’exemple de voyages français en Russie au XIXe siècle
Aннотация
L’imagologie étudie les représentations, dans une œuvre littéraire, de l’étranger : pays et peuples. Cette forme de critique s’est donné un domaine précis. A travers l’étude de quelques récits de voyages français du XIXe siècle (Mme de Staël, Dumas, Gautier) en Russie, on peut observer la création et la transformation des images dans les voyages et la fiction, les deux genres échangeant leurs représentations de l’altérité.
La représentation que l’on se fait des « autres », de l’« étranger », peut naître de plusieurs façons : essentiellement par les représentations purement imaginaires ou fantasmatiques suscitées par le ouï-dire et les légendes ; par les récits, la littérature ou les objets ‘exotiques’, au sens propre ‘venus de l’extérieur’ ; par le contact effectif (lors de voyages vers d’autres pays, ou par l’accueil d’étrangers). Récits et voyages alternent dans le temps : ils peuvent mutuellement se suivre ou se précéder.
La littérature de voyage offre un champ privilégié pour l’étude des représentations (appelée aussi « imagologie »). En effet toute relation est révélatrice d’une certaine vision du monde, parce qu’elle n’existe qu’en fonction d’un point de vue, et s’écrit selon certains critères souvent implicites, voire inconscients. Les voyageurs qui arrivent dans un lieu inconnu sont toujours frappés par ce qui diffère de leurs habitudes, sur fond de reconnaissance d’éléments familiers. Cette observation concerne évidemment le paysage, les abords, les ressources – réaction normale pour des marins ou des découvreurs, surtout lorsqu’ils atterrissaient dans des lieux inconnus, non ou peu cartographiés, ou comme les aventuriers qui se réjouissent de visiter des lieux peu décrits où ils peuvent s’imaginer être des « voyageurs » et non des « touristes ». Cette observation est encore plus sensible lorsqu’il s’agit de décrire les populations rencontrées, leur allure et leurs coutumes. Mais ils sont tributaires de tellement de biais possibles qu’il est difficile de considérer que l’image qu’ils renvoient, devenue un kaléidoscope, correspond à une réalité exacte. Les critiques refusent d’ailleurs de considérer cette question de l’adéquation au réel – peut-être parce que ce ne serait pas une activité proprement littéraire.
De fait, la lecture de ces récits a été faite dans leur société d’origine, d’abord. Parfois, ensuite, elle a été lue, et parfois « récupérée » dans la société qui avait été décrite : ce miroir tendu est évidemment un miroir déformé et déformant, dans lequel il peut être tentant de se complaire. L’étude du genre humain telle que la conçoit Rousseau ne relève pas de l’universalisme. En fait, écrit-il dans l’Essai sur l’origine des langues,
« Quand on veut étudier les hommes il faut regarder près de soi ; mais pour étudier l’homme il faut apprendre à porter sa vue au loin ; il faut d’abord observer les différences pour découvrir les propriétés. » [11, P. 89-89]
Par cette remarque, d’ailleurs, il ne fonde rien de moins que l’anthropologie, ou « science de l’homme », sans utiliser ce vocable : en effet il établit les concepts quoiqu’il ne les nomme pas.
Sans avoir donc la prétention de rajouter des banalités à la multitude des images qui circulent, je voudrais m’intéresser à la manière dont ces images se sont construites, les filtres qui ont coloré cette appréhension, et la manière dont les voyageurs et les écrivains ont géré ces images en les élaborant, en les reproduisant telles quelles ou au contraire en les modifiant.
Les exemples seront tirés en particulier des voyages de Français en Russie (et surtout au XIXe siècle), et des textes plus ou moins fictionnels qui les accompagnent ou les remplacent : comme ceux de Germaine de Staël (Dix ans d’exil, 1818), d’Astolphe de Custine (La Russie en 1839, 1843), Alexandre Dumas (Impressions de voyage en Russie, 1865-1866), qui avait fait précéder son voyage d’un roman à sujet russe, Le Maître d’armes (1840-1841), et Théophile Gautier (Voyage en Russie, 1866).
I. Qu’est-ce que l’imagologie ?
Le premier article qui cherche vraiment à le définir est celui de Daniel-Henri Pageaux, dans le Précis de littérature comparée dirigée par Brunel et Chevrel en 1989. La définition donnée par Pageaux, la plus simple, est « l’étude des images de l’étranger dans une œuvre » [10, P. 133] ;
« toute image procède d’une prise de conscience, si minime soit-elle, d’un Je par rapport à l’Autre, d’un Ici par rapport à un Ailleurs. L’image est donc l’expression, littéraire ou non, d’un écart significatif entre deux ordres de réalité culturelle. Ou encore : l’image est la représentation d’une réalité culturelle au travers de laquelle l’individu ou le groupe qui l’ont élaborée (ou qui la partagent ou qui la propagent) révèlent et traduisent l’espace culturel et idéologique dans lequel ils se situent. » [10, P. 135]
Il attribue à Jean-Marie Carré, en 1951, l’expression de l’« interprétation réciproque des peuples, des voyages et des mirages » [10, P. 133]. L’imagologie se propose d’étudier l’image de pays étrangers dans les œuvres littéraires, passées par le filtre du regard de l’écrivain et transformées pour devenir matière littéraire ou artistique. Comme dans le processus de la condensation, cette représentation n’est pas la simple reproduction du réel mais l’assemblage de traits choisis comme signifiants, chargés de connotations plus ou moins stéréotypées, propres à construire une image plus « vraie » que nature. Selon Jean-Marc Moura, l’image s’est en quelque sorte spécialisée de côté de l’imaginaire : la question du référent, y compris lorsqu’elle révèle en soi l’écart avec le temps passé, serait plus ou moins évacuée ; considérant que « le véritable enjeu d’une étude d’image est la découverte de sa "logique", "de sa vérité", non la vérification de son adéquation à la réalité. » [9, P. 40]. Pour Pageaux :
« Le texte imagologique sert à quelque chose dans et pour la société dont il est l’expression fugitive et parcellaire. C’est que l’image de l’Autre sert à écrire, à penser, à rêver autrement. En d’autres termes : à l’intérieur d’une société et d’une culture envisagées comme champs systématiques, l’écrivain écrit, choisit son discours sur l’Autre, parfois en contradiction totale avec la réalité politique du moment : la rêverie sur l’Autre devient un travail d’investissement symbolique continu. Si, au plan individuel, écrire sur l’Autre peut aboutir à s’autodéfinir, au plan collectif, dire l’Autre peut aussi servir les défoulements ou les compensations, justifier les mirages ou les fantasmes d’une société. » [10, P. 151]
Cet imaginaire serait donc, d’une certaine façon, plus éloigné de la réalité qui a suscité le discours que de l’imaginaire de la société qui la produit ou permet à un écrivain de la produire.
Il s’ensuit que l’imagologie étudie aussi, dans le récit de voyage, l’écart particulier entre le récit convenu dans une société donnée et la version originale délivrée par le voyageur ou par l’auteur, ce qui équivaut à prendre en compte son esthétique propre. L’anthropologie culturelle se conjugue avec l’actualisation artistique ou romanesque, par le choix de la forme ou de l’expression.
Cependant les critiques actuels rejettent, comme étant « dépassées », les théories de « caractères nationaux » élaborées au siècle des Lumières, qui en effet tendent à réduire le tempérament supposé d’un peuple à un seul trait, ou à un faisceau de traits communs repérables et stéréotypés. C’est probablement pour éviter de poser la question du stéréotype national, qui aujourd’hui n’a sans doute plus grand sens, que les études imagologiques réduisent ces caractères à des ingrédients imaginaires ou artistiques sans lien avec la question de la vérité. Il est du reste évident que réduire un peuple à quelques traits c’est méconnaître les différences entre individus, indépendantes de la nation ou du pays, et essentialiser certaines caractéristiques dans lesquelles les personnes ne se reconnaissent pas. C’est ce que décrit Amin Maalouf dans Les identités meurtrières [6]. Au XIXe siècle, c’est pourtant le plus souvent la grille d’analyse, ce que prouve (tout en le nuançant) Madame de Staël à propos des Russes – stéréotype et variation individuelle :
« Le caractère de ce peuple est de ne craindre ni la fatigue ni les souffrances physiques ; il y a de la patience et de l’activité dans cette nation, de la gaieté et de la mélancolie. On y voit réunis les contrastes les plus frappants, et c’est ce qui peut en faire présager de grandes choses ; car d’ordinaire, il n’y a que les êtres supérieurs qui possèdent des qualités opposées ; les masses sont, pour la plupart, d’une seule couleur. » [12, P. 247-248]
Ce genre de remarque ne peut se concevoir que dans une société très marquée par des classes sociales hiérarchisées.
Il convient donc d’étudier le contexte dans lequel naissent les images, mais aussi les prolongements tant dans la société qui produit les images (celle dans laquelle vit celui qui décrit) que dans la société qui suscite les images (le monde qui est décrit ou reconstitué, voire composé ou imaginé). Comme le souligne T. Todorov, « Les jugements que portent les nations les unes sur les autres nous informent sur ceux qui parlent, non sur ceux dont on parle. » [14, P. 28] Pour Alain Montandon, même,
« Il faut une conscience nationale – c’est-à-dire le sentiment d’appartenance à un groupe historique, linguistique, culturel et politique – pour que puissent se dessiner des caractères nationaux (une telle conscience nationale est loin d’être toujours précise, et parce qu’elle est souvent indéterminée, elle se dessine la plupart du temps par opposition : l’autre est ce que je ne suis pas ; je suis ce que l’autre n’est pas).
Aborder le problème de manière générale soulève de nombreuses difficultés. En raison même d’abord de cette conscience nationale qui évolue au cours de l’histoire et des images différentes forgées au cours des temps, des évolutions et des révolutions. Ainsi la compréhension du caractère de l’étranger est-elle variable suivant les époques : elle n’est pas la même sous l’ancien régime, sous la Révolution, au XIXe ou au XXe siècle. » [8, P. 254]
Ces variations émanent du contexte historique et idéologique, mais aussi de la mode littéraire. Il ne faut donc pas s’y fier, mais on peut l’étudier comme un moment de l’histoire.
II. L’observation du voyageur
Il semble acquis qu’étudier le degré de fidélité d’une image au réel est un « faux problème » [10, P. 136] : mais il reste à se demander vraiment pourquoi. Car en général les écrivains ont affirmé qu’ils tentaient d’être fiables et de dire la vérité, au moins en plus grande partie. Rares sont ceux qui proclament qu’ils vont mentir ou propager des fadaises – à moins de se moquer des prétentions de leurs prédécesseurs ou parodier le genre de la relation de voyage.
En réalité les distorsions existent, car nul ne dit exactement la vérité même s’il se propose de le faire. Par exemple, Custine (en 1839) jure dans son Avant-propos qu’il n’y a pas voyageur plus honnête que lui :
« J’arrive dans un pays nouveau sans autres préventions que celles dont nul homme ne peut se défendre : celle que nous donne l’étude consciencieuse de son histoire. J’examine les objets, j’observe les faits et les personnes en permettant ingénument à l’expérience journalière de modifier mes opinions. Peu d’idées exclusives en politique me gênent dans ce travail spontané où la religion seule est ma règle immuable ; encore cette règle peut-elle être rejetée par le lecteur sans que le récit des faits et les conséquences morales qui en découlent soient entraînés dans la réprobation que j’encours […].
On pourra m’accuser d’avoir des préjugés, on ne me reprochera jamais de déguiser sciemment la vérité.
Quand je décris ce que j’ai vu, je suis sur les lieux ; quand je raconte ce que j’ai entendu, c’est le soir même que je note mes souvenirs du jour. Ainsi, les conversations de l’Empereur, reproduites mot à mot dans mes lettres, ne peuvent manquer d’un genre d’intérêt : celui de l’exactitude. […] Il me semblait qu’en disant la vérité sur la Russie, je ferais une chose neuve et hardie : jusqu’à présent la peur et l’intérêt ont dicté des éloges exagérés ; la haine a fait publier des calomnies : je ne crains ni l’un ni l’autre écueil. » [1, P. XXII-XXIV]
D’autant plus qu’en règle générale l’image colportée est instrument de pouvoir. Venue de l’extérieur (d’un « sujet »), elle prend l’ascendant sur ce qu’elle décrit (son « objet »). La calomnie, le commentaire dépréciatif sont susceptibles d’être répétés, amplifiés, comme l’est la rumeur. On voit cependant qu’il développe, comme un contre-modèle, les risques d’inexactitude les plus courants : sur la manière de percevoir les choses, les filtres variés que sont le sentiment national ou chauvin, le préjugé et le parti-pris dogmatique, l’idéologie politique, la religion, la peur, l’intérêt, la haine ; et sur le plan de l’écriture, l’information de seconde main, l’oubli ou la négligence, la liberté stylistique… Il précise même qu’il ne songeait pas à publication et que ses informations sont transmises par lettres, au plus près du réel. Il se défend de tous ces défauts qui empêchent habituellement de voir correctement – par métier, par origine, par nationalité ou toute autre raison –, ces penchants souvent inconscients qui forment un écran invisible déformant la vue ou pervertissant le récit. Ces erreurs s’attachent à tous les aspects de la communication de l’information, autant dans le regard porté que dans le désir de manipuler le lecteur.
Plusieurs périodes grossièrement historiques, dans l’histoire des voyages, peuvent illustrer ce rapport au réel, cette évolution et cette manipulation éventuelle : dans un premier temps, les voyages et les représentations collectives conduisent de façon aléatoire à l’élaboration de l’image. Dans un deuxième temps, cette image se diffuse et a tendance à se cristalliser, à se figer : elle devient consensuelle au sein d’une société qui n’a pas toujours les moyens de vérifier plus avant, en allant sur place, sa conformité avec la réalité. Dans un troisième temps, ces images conduisent à la reprise immédiate, ou à la citation ornementale, ou à la reprise distanciée ou ironique, ou encore à la rétorsion pour tenter de déjouer l’emprise de stéréotypes erronés.
Ainsi la première période est celle des observations sur place et de la relation : le plus souvent la surprise fait remarquer des différences, des traits saillants (plutôt que des banalités communes à tous les peuples). Comme le dit Alexandre Dumas, partant pour Saint-Pétersbourg,
« Voyager avec les bateaux des messageries, c’est toucher Malte, Syra, Alexandrie, Beyrouth, Smyrne et Constantinople ; c’est voir tout ce que le monde voit, c’est raconter mieux ou moins bien que les autres, mais enfin c’est raconter après les autres. Or le voyage que je veux faire, moi, c’est un voyage que personne n’a fait jusqu’à présent. » [2, P. 9]
L’image change selon le métier du voyageur, son idéologie, son expérience, l’époque. S’exprimeront différemment le simple voyageur, le savant, le missionnaire, le linguiste, l’observateur tenté par l’ethnologie, qui évalue mœurs, religion, organisation sociale… Tous disent être de la plus exacte véridicité. Chacun a sa façon de voyager et de rendre compte. Comme le remarque Théophile Gautier,
« En voyage, il n’y a que deux manières, l’épreuve instantanée ou la longue étude. Le temps nous fait défaut. Daignez donc vous contenter de cette simple et rapide impression. » [4, P. 11]
On peut donc affirmer que le rapport au réel est secondaire, le regard et l’histoire du voyageur expliquent malgré tout beaucoup de choses dans la création de cette première image qui déterminera les autres.
La deuxième période est celle de l’interprétation des textes et de la production de textes secondaires. Ces textes deviennent des guides de voyage, des ouvrages de géographie, des ouvrages d’ethnographie… Cette deuxième période est passionnante dans le sens où les voyageurs comme les lecteurs sont conscients des biais et tentent de les réduire au maximum à des fins scientifiques, ou les utiliser à des fins plus pernicieuses – à moins que, tout simplement, la fiction ne s’empare de ces données pour composer un nouveau monde parallèle. Le meilleur exemple est celui du roman russe que Dumas écrivit en 1840-1841, Le Maître d’armes. On y trouve des passages manifestement très informés sur la Russie, toponymes, état des routes et des voitures, termes russes… :
« Au sortir de Tsarskoïe Selo, l’essieu d’un droschki qui courait devant moi se rompit tout à coup, et la voiture, sans verser, s’inclina sur le côté. » [3, P. 11]
Il s’est inspiré de sources comme Jacques Ancelot (Six mois en Russie, 1838), Dupré de Saint-Maure (L’Hermite en Russie, ou observations sur les mœurs et les usages russes au commencement du XIXe siècle, 1829), ou Jean-Baptiste May (Saint-Pétersbourg ou la Russie en 1829, 1830). Il semble cependant qu’à la suite de ce roman à décor historique, Dumas n’ait pas été le bienvenu en Russie jusqu’à la mort du tsar Nicolas 1er, en 1856. Ses impressions de voyage vont modifier sa perspective sur la Russie, et ses remarques peuvent offrir un nouveau visage du pays et de ses habitants.
Le troisième temps est celui de la confirmation – ou de l’infirmation – des idées reçues : le point de vue subjectif peut venir du désir de faire connaître (c’est le cas des correspondants de journaux, des reporters). Par jeu, par facilité ou par commodité, peut s’effectuer alors la reprise des pires stéréotypes. C’est ainsi que Gautier parle d’un roman d’Alexandre Dumas pour appuyer ses descriptions auprès de ses lecteurs et y trouver confirmation de ses observations !
« Tous ceux qui ont lu Monte-cristo se souviennent de ce repas où l’ancien prisonnier du château d’If, réalisant les merveilles des fééries avec une baguette d’or, fait servir un sterlet de la Volga, phénomène gastronomique inconnu sur les tables les plus recherchées, en dehors de la Russie. » [4, P. 132]
Le même Théophile Gautier s’appuie aussi sur ses propres observations pour rectifier les images reçues.
« Le gentilhomme et le tchinovnik (employé) se distinguent nettement de l’homme du peuple par le frac ou l’uniforme. Le marchand garde son caftan asiatique et sa large barbe ; le moujik sa chemise rose débordant en blouse, ses culottes bouffantes entrant dans les bottes, ou, pour peu que la température s’abaisse, sa touloupe graisseuse ; car les Russes, de quelque classe qu’ils soient, sont généralement assez frileux, bien qu’en occident on s’imagine qu’ils bravent, sans en souffrir, les froids les plus rigoureux. » [4, P. 376]
Il exhibe comme preuve quelques mots russes, certains connus, d’autres moins. Par exemple, le « moujik » est déjà presque entré dans la langue, signalé sous la forme « mousique » dans un Voyage de Moscovie d’un certain Pierre Deschisaux en 1727 [16] ; il n’en va pas de même du mot « touloupe », employé à plusieurs reprises dans la relation, presque toujours accompagnés de l’adjectif « graisseuse ». Le terme est signalé en français en 1768, « subst. fém. touloppe “vêtement d'hiver en peau de mouton retournée des paysans russes” (J. Chappe d’Auteroche, Voyage en Sibérie, vol. I, p. 50 » [16]. Il semble que le mot « tchinovnik » n’apparaisse en français qu’avec la traduction de L’Idiot de Dostoïevski (1868-1869, traduit en 1887 par Victor Dérély). Le véritable voyageur attentif peut donc jouer de tous ses atouts, ses connaissances et ses observations ; mais on voit qu’il a le souci de son lectorat, et veut lui faire goûter l’atmosphère de la Russie – ou plutôt une atmosphère particulière.
III. Le voyage des stéréotypes : expressions et images
Dans certains cas, cette reprise des clichés répond à une attente du lectorat, presque une commande : celle de l’exotisme, ou d’abord, tout simplement, la poésie des mots.
« Qu’est-ce qui nous fait voyager ? […] L’appel de l’espace se trouve en nous. Cela pourrait s’énoncer comme une loi malheureusement incontournable: tout voyage a un horizon verbal. Pour partir, il faut un pré-texte, une excuse, un mobile. Les mots, en effet, ne seraient-ils pas les données premières de la rêverie géographique ? Entendons par là les mots sucrés, les mots exotiques, les mots-valises du voyage. Il y en a des milliers. Ils se combinent entre eux et se pensent en nous […], noms de lieux, avec leurs consonances bizarres, leurs onomatopées, leurs poèmes sous-jacents. » [7, P. 11]
Il ne fait que reprendre ainsi des réflexions déjà formulées par des prédécesseurs, comme Germaine de Staël :
« Tous ces noms de pays étrangers, de nations qui ne sont presque plus européennes, réveillent singulièrement l’imagination. On se sent en Russie, à la porte d’une autre terre, près de cet Orient d’où sont sorties tant de croyances religieuses, et qui renferme encore dans son sein d’incroyables trésors de persévérance et de réflexion. » [12, P. 250]
Gautier dans le Voyage en Russie s’avoue fasciné par le nom plein de promesses de Nijni-Novgorod :
« Nous connaissions Saint-Pétersbourg, Moscou, mais nous ignorions Nijni-Novgorod. Et Comment peut-on vivre sans avoir visité Nijni-Novgorod ?
D’où vient que le nom de certaines villes vous préoccupe invinciblement l’imagination et bourdonne pendant des années à vos oreilles avec une merveilleuse harmonie, comme ces phrases musicales retenues par hasard et qu’on ne peut chasser ? – C’est une obsession bizarre bien connue de tous ceux qu’une détermination subite en apparence pousse hors des limites de leur patrie, vers les points les plus excentriques. Le démon du voyage susurre près de vous les syllabes d’incantation. […]
Nijni-Novgorod exerçait depuis longtemps déjà cette inéluctable influence sur nous. Aucune mélodie ne résonnait plus délicieusement à notre ouïe que ce nom vague et lointain ; nous le répétions comme une litanie sans en avoir presque la conscience ; nous le regardions sur les cartes avec un sentiment de plaisir inexplicable ; sa configuration nous plaisait comme une arabesque d’un dessin curieux. Le rapprochement de l’i et du j, l’allitération produite par l’i final, les trois points qui piquent le mot comme ces notes sur lesquelles il faut appuyer, nous charmaient d’une façon puérile et cabalistique. Le v et le g du second mot possédaient aussi leur attraction, mais l’od avait quelque chose d’impérieux, de décisif et de concluant, à quoi il nous était impossible de rien objecter. – Aussi, après quelques mois de luttes, nous fallut-il partir. » [4, P. 367-368]
Ainsi cette représentation conforte, chez le lecteur, l’illusion de la connaissance par le raccourci, le mot et ses connotations. La nécessité objective que l’image soit un simple dénoté, et non un signe complexe, échappe à beaucoup de lecteurs. La représentation de la Russie par les voyageurs suffit à convaincre généralement, et la rectification, la précision, ne sont pas toujours bienvenues. Les récits se combinent avec les romans, qui imaginent et font imaginer : même s’ils prennent des distances avec le réel, ils gardent un réel pouvoir de création à l’origine de représentations qui équivalent, dans l’esprit du plus grand nombre, à la réalité elle-même. Combien de lecteurs s’imaginent les steppes russes grâce au roman de Jules Verne Michel Strogoff (1876) [15] ! Cependant le roman à visée « ethnographique » ou didactique, et le roman de pure fantaisie. Dans le premier, il s’agit de transposer une réalité observée et la retranscrire sous forme dramatisée pour lui donner plus d’agrément et frapper la mémoire et l’imagination. Dans le second, le roman de pure fiction, l’intrigue pourrait se dérouler n’importe où et le décor est de carton-pâte, une sorte de « village Potemkine »… si cette image n’est pas elle-même une fiction. Car le lectorat français interprète l’histoire russe à sa façon, se constitue sa propre image du « peuple russe » ou de « l’âme slave ».
En même temps, on voit que l’impact des récits et de l’image de l’autre est important dans la société pour laquelle ils ont été écrits : les mots sont entrés dans la langue, et avec eux une porte s’est ouverte vers l’altérité. Certains récits ont été inexacts, fantaisistes, distordus par des biais variés tant personnels que collectifs : Théophile Gautier ou Dumas ont voyagé en écrivains – et en bons vivants, ils ont retenu des traits piquants et ont parfois arrangé les choses pour que la relation soit plus plaisante, ou serve de matériau à un roman futur – comme, pour Dumas, Sultanetta ou La Boule de neige, deux romans nés du voyage et publiés en 1859. Aussi bien l’un que l’autre ont rapporté de leurs voyages, en Espagne ou en Russie, par exemple, des recettes et des descriptions de menus ; ce qui est propre, à leurs yeux, à recréer une sensation plus complète de la vie en Russie. Madame de Staël analyse la société de son point de vue de femme émigrée, et la Russie achève son tour d’Europe en Dix ans d’exil : sa vision est ainsi plus politique que celle de bien des hommes venus en touristes.
En outre, ces voyages et ces fantaisies sont nécessairement compensés par des textes plus analytiques, comme celui de Guénin en 1891, intitulé La Russie. Histoire, géographie, littérature.
« Les livres spéciaux, les histoires bien faites et remontant aux sources, les relations de voyages ne manquent pas sur la Russie, et cependant aucun de ces ouvrages n’a pénétré dans le grand public dans ces masses profondes où la sympathie pour les Slaves est la plus ardente […].
C’est cette lacune que nous espérons combler en publiant ce volume où l’on trouvera résumée, en vue des nombreux lecteurs à qui le temps et la fortune ne laissent ni loisirs pour de longues recherches ni superflu pour l’acquisition d’ouvrages d’un prix souvent élevé, toute l’histoire de la Russie et de ses agrandissements successifs. Nous y avons joint quelques notions géographiques et ethnographiques, des détails utiles à connaître sur l’armée, ainsi qu’une étude, que nous aurions voulu étendre davantage, sur la littérature slave et ses tendances. La liste des ouvrages les plus essentiels à consulter pour les personnes qui désireront remonter elles-mêmes aux sources termine le volume. » [5, P. 7-8]
Le but est donc de proposer une somme, qui synthétisera des points de vue différents sans prendre parti. Il n’est pas sûr qu’une telle entreprise puisse complètement réussir, parce que, ici encore, se dessine une intention, le désir des auteurs d’impliquer leur texte dans une action, que ce soit déclencher le désir de voyage, instruire ou moraliser sur la découverte du différent.
Conclusion
L’image est donc complexe. Née le plus souvent du voyage ou de l’intérêt pour l’autre, elle n’est jamais neutre, en plus du fait que la langue introduit une dimension supplémentaire. Reçue au XIXe siècle par une société curieuse, elle va se fixer sous la forme d’un faisceau de traits distinctifs.
« Rien ne se fait en Russie comme ailleurs ; mais, lorsque l’on connaît bien la Russie, on finit par arriver à son but. Le chemin est un peu plus long et un peu plus accidenté, voilà tout. » [2, P. 633] conclut Alexandre Dumas. Rien ne caractérise mieux l’image de l’écrivain-voyageur que ce jugement porté après un long périple. Certes, il ne répugne pas à faire un bon mot, et à tirer une morale de philosophe de déboires dont il serait vain de se plaindre. C’est en même temps le constat de la différence, et la vanité foncière de ce constat. Ce sont assurément des petits morceaux étranges qui éveillent l’imagination. L’image peut servir de véhicule, mais comme le disait aussi le philosophe Sénèque, « À quoi sert de voyager si tu t’emmènes avec toi ? C’est d’âme qu’il faut changer, non de climat.»
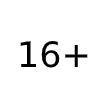


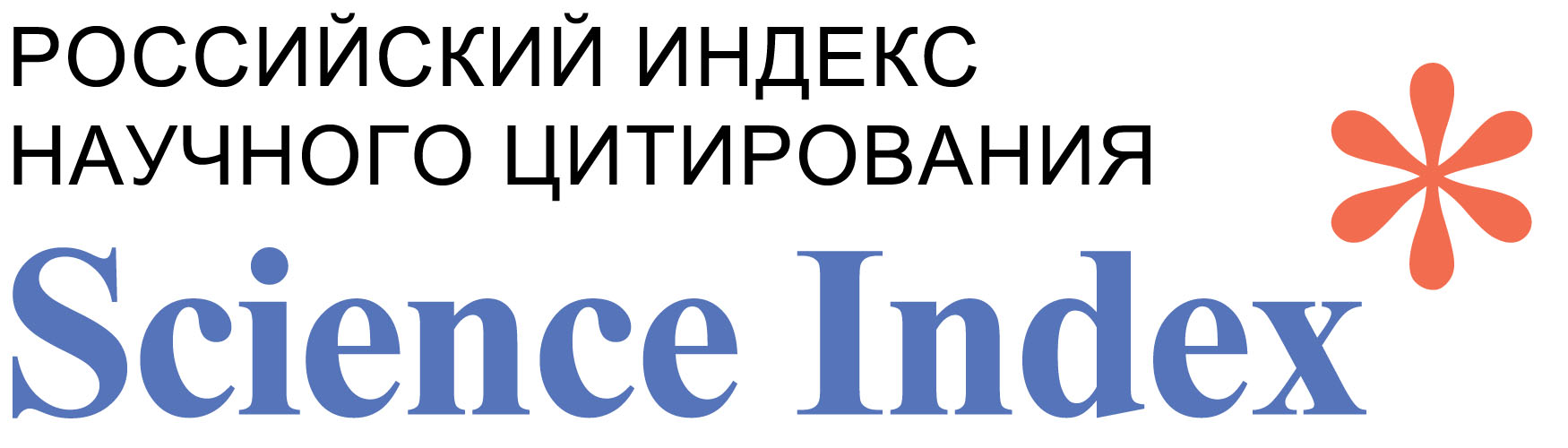




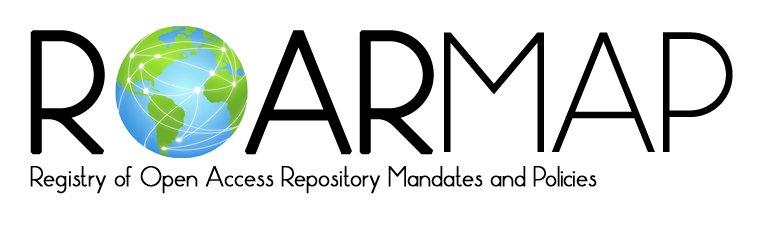

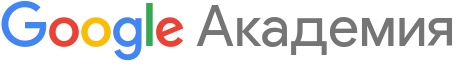


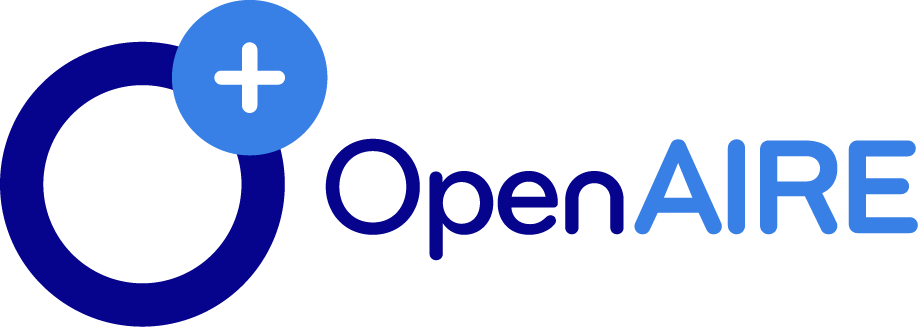




Список литературы
1. Custine Astolphe de. La Russie en 1839. Paris : Librairie d’Amyot, 1843.
2. Dumas Alexandre. En Russie. Impressions de voyage [1859-1862]. Paris : Ed. François Bourin, 1989.
3. Dumas Alexandre. Le Maître d’armes [1840]. Paris : Le Vasseur, 1909.
4. Gautier Théophile. Voyage en Russie [1866]. Paris : Charpentier, 1875.
5. Guénin Eugène. La Russie. Histoire, géographie, littérature. Paris : Savine, 1891.
6. Maalouf Amin. Les Identités meurtrières [1998]. Paris : Grasset / Le livre de Poche, 2003.
7. Meunier Jacques. Le Monocle de Joseph Conrad. Paris : Payot, 1993, «Petite Bibliothèque Payot»
8. Montandon Alain. «L’étude des caractères nationaux dans la littérature française : problèmes de méthode». Cahiers de l'Association internationale des études françaises, 2002, vol. 54, n° 1, pp. 251-269.
9. Moura Jean-Marc. L’Europe littéraire et l’ailleurs. Paris : PUF, 1998.
10. Pageaux Daniel-Henri. «De l’imagerie culturelle à l’imaginaire», in Pierre Brunel, Yves Chevrel (dir.). Précis de littérature comparée. Paris : PUF, 1989, pp. 133-162
11. Rousseau Jean-Jacques. Essai sur l’origine des langues [1761-1781]. Paris : Gallimard, 1990, «Folio».
12. Staël Germaine de. Dix années d’exil [posthume, 1818]. Œuvres complètes de Mme la baronne de Staël, t. 15. Paris : Treuttel et Wurtz, 1820-1821.
13. Świderska Małgorzata. «Comparativist Imagology and the Phenomenon of Strangeness», Comparative Literature and Culture 15.7 (2013): <http://docs.lib.purdue.edu/clcweb/vol15/iss7/10> Special Issue New Work in Comparative Literature in Europe, ed. M. Grishakova, L. Boldrini, and M. Reynolds
14. Todorov Tzevtan. Nous et les autres. Paris : Le Seuil, 1989
15. Verne Jules. Michel Strogoff. Paris : Hetzel, 1876
16. ––. Dictionnaire du CNRTL, <http://www.cnrtl.fr>